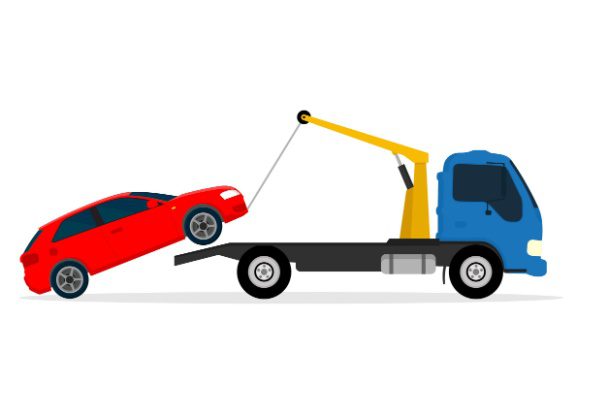La carte des pratiques et montages abusifs recense des schémas révélés lors de contrôles fiscaux et remis en cause par l’administration fiscale en raison de leur caractère frauduleux. Cette carte vient récemment de s’enrichir d’un nouveau schéma. Lequel ?
Montage abusif et dispositif anti-abus : illustration
Dans un souci de prévention et de sécurité juridique, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) met à disposition du public une carte recensant les pratiques et montages fiscaux abusifs susceptibles d’être remis en cause par l’administration fiscale, notamment à l’occasion d’un contrôle fiscal.
Cette carte, régulièrement actualisée, présente différents exemples concrets de montages révélés au cours de contrôles fiscaux et contraires à la loi.
Un nouveau schéma y a récemment été ajouté : celui lié au portage salarial.
Dans certains milieux professionnels, il est fréquent qu’une personne domiciliée en France ne perçoive pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à une structure étrangère qui est chargée de lui reverser une partie de sa rémunération.
Le problème de ce type de montage est qu’il permet de faire échapper à l’impôt français des sommes qui, normalement, auraient dû être taxées en France.
C’est pourquoi il existe un dispositif anti-abus qui permet, toutes conditions remplies, de taxer à l’impôt français les sommes versées à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies à l’étranger, dès lors que les services rémunérés ont été exécutés en France par une ou plusieurs personnes domiciliées en France.
Prenons l’exemple fourni par la carte de la DGFIP.
Monsieur G., résident fiscal français et consultant en informatique, est imposable à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
Il travaillait pour des entreprises françaises qui le rémunéraient directement pour ses prestations.
Il décide d’abandonner son statut d’indépendant pour devenir employé salarié d’une société étrangère qui propose des services informatiques.
Sa clientèle française continue de faire appel à lui, mais désormais via des contrats de sous-traitance conclus avec la société étrangère, qui émet les factures correspondantes et perçoit les règlements.
En contrepartie des prestations qu’il réalise chez les clients, Monsieur G est rémunéré par des salaires versés par la société étrangère.
La société étrangère n’a en pratique aucune activité économique réelle : elle se limite à des fonctions administratives telles que la facturation ou la gestion des consultants. En clair, les honoraires qu’elle perçoit ne rémunèrent aucune prestation propre, mais correspondent en réalité au travail effectué par Monsieur G.
Sur le plan fiscal, Monsieur G déclare en France des revenus de source étrangère, bénéficiant ainsi d’un crédit d’impôt destiné à éviter une double imposition. Ce schéma lui permet de dissimuler sa véritable qualité de prestataire et de minorer l’imposition de ses revenus professionnels issus d’une activité exercée en France. En outre, bien qu’il ne paie aucun impôt à l’étranger, il profite indûment d’un crédit d’impôt.
Sur le plan social, ce montage peut également permettre à Monsieur G d’éluder les contributions et cotisations sociales dues au titre d’une activité indépendante, tout en ouvrant droit à des prestations sociales françaises.
Par exemple, après une démission ou un licenciement fictif de la société étrangère, puis une brève embauche en France, Monsieur G pourrait prétendre à des allocations chômage sur la base de l’activité exercée via la société étrangère.
En application du dispositif anti-abus, l’administration fiscale réintègre les sommes perçues par la société étrangère dans les revenus du consultant, comme si cette société n’avait jamais existé. Les sommes sont donc imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Ces sommes étant la contrepartie de prestations réalisées par un résident de France à destination de clients situés en France, elles sont en tout état de cause uniquement imposables en France.
Les rappels d’impôt sur le revenu et la reprise des crédits d’impôt indus effectués par l’administration fiscale peuvent être assortis de l’intérêt de retard et d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, sans exclure d’éventuelles poursuites pénales.
Il faut en outre noter que, dans cette hypothèse, les sociétés clientes qui acceptent sciemment les factures de complaisance émises par la société étrangère encourent l’application d’une amende de 50 % des montants facturés.
Notez pour finir que l’administration fiscale pourra être amenée à signaler ce type de montage et les personnes impliquées à l’administration sociale et invite toute personne qui a réalisé de telles opérations à prendre contact avec elle pour régulariser sa situation.
Pratiques et montages fiscaux abusifs : un nouveau cas dans le viseur ! – © Copyright WebLex